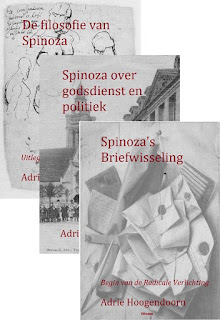Een boek over Spinoza's 'universele animisme'
Een consequentie van Spinoza’s parallellisme is dat hij tot een universeel
animisme komt, moet komen. Dat algemene animisme moet niet opgevat worden alsof
alles denkt (over een soort brein beschikt), maar betekent dat er van alles in
God of de natuur een adequaat idee bestaat. Spinoza drukt er de principiële
intelligibiliteit van de werkelijkheid mee uit: we kunnen God of de natuur
kennen, omdat die ‘kennis’ (ideae) al in de natuur vervat zit(ten).
Leibniz heeft beschouwingen gewijd over een universele geest (esprit), bij Spinoza
vindt je die niet. En er is zeker geen aanleiding om bij Spinoza iets als een ‘universeel
(zelf)bewustzijn’ aan te nemen. Er wordt op dit punt erg veel beweerd of
aangenomen. Iemand die hiernaar uitvoerig studie heeft gedaan is Renée
Bouveresse.
Renée Bouveresse-Quilliot est une philosophe française. Ancienne élève
de l'ENS, agrégée de philosophie, docteur en philosophie et psychologie, elle
est actuellement maitre de conférence à l'Université de Bourgogne. Elle
travaille notamment sur la pensée de Wittgenstein et de Karl Popper, la
critique de la psychanalyse et l'esthétique. Elle est considérée comme une des
spécialistes françaises de Karl Popper [Cf hier en bij Wikipedia].
Ze hield zich ook uitgebreid met Spinoza bezig; zie overzicht bij WorldCat en bij haar uitgever Vrin. Hier gaat het uiteraard om haar Spinoza-studie en wel i.h.b.
Renée Bouveresse, Spinoza et Leibniz: l'idée d'animisme universel: etude suivie de la traduction inédite d'un texte de Leibniz sur l'Ethique de Spinoza et d'un texte de Louis Meyer. Vrin, 1992 - 335 pagina’s - books.google
[Op de achterkant:] Chez l'auteur de l'Ethique, comme chez celui de la Monadologie,
l'animisme universel est lié au dépassement du mécanisme cartésien, et
s'accompagne du refus de l'idée d'une Ame du monde et de la transmigration des
âmes. Mais là où Spinoza place la pensée et l'étendue sur un pied d'égalité,
Leibniz en vient à une spiritualisation de la matière ; et sa conception
s'inscrit, à la différence de Spinoza, dans la tradition biologique de
l'animisme, même si l'âme, principe de vie, n'agit pas selon lui sur le corps.
C'est sur la constitution et la signification de ces deux animismes universels
que la présente étude cherche à s'interroger.
Elargissant par ailleurs sa perspective en étudiant les écrits de Leibniz sur
Spinoza, elle rouvre la question de l'influence positive que le second a pu
exercer sur le premier, en ce qui concerne aussi bien le parallélisme que
l'animisme universel. Elle montre que le panpsychisme leibnizien, renforcé par
son appui sur la mathématique universelle, constitue une version atomiste de celui
de Spinoza.
On trouvera en appendice la traduction inédite d'un texte de Leibniz sur l'Ethique, et d'un texte de Louis Meyer.
Spinoza heeft het, zo lijkt het, slechts op één plaats in de Ethica [2/13s] in een tussenzinnetje erover dat alles, hoewel in diverse gradaties, bezield (animata) is. Knap dat daar dan een boek van honderden pagina’s over geschreven kan worden. Ze wijst echter op méér passages, zowel in de Ethica als de KV, waaruit blijkt dat Spinoza zich er toch meer over heeft geuit en er bij Spinoza inderdaad van een universeel animisme sprake is dat niet alleen afgeleid kan worden uit die ene passage die ook de titel vormde van een eerder artikel van haar
Renée Bouveresse, "Omnia, quamvis diversis gradibus, animata sunt" - Remarques sur l'idee d'animisme universel chez Spinoza et Leibniz, in: Michel Delsol (Dir.), Spinoza - Science et Religion: De la Méthode Géométrique a l'interprétation de l'Écriture Sainte [Actes du Colloque organisé par Renée Bouveresse [...] au Centre Culturel International de Cerisy-la Salle du 20 au 27 septembre 1982], Paris: Vrin, 1988: 33-45.
Ze citeert en vertaalt naar het Frans, een passage uit Karl Popper, John Eccles, The Self and its Brain [Springer, 1977, p. 184], die ik hier via books.google weer in het origineel weergeef:
One sees that, and why, Spinoza must be
a pantheist: since there is no other essence or substance in the universe than
God, God must be identical with the essence or substance of the universe, with
nature.
One also sees that, and why, Spinoza must be a panpsychist: mind is an
attribute and an aspect of the one substance; so there are mental aspects
running everywhere parallel to all material aspects.
Verder nog van haar te noemen:
Renée Bouveresse, “Une lettre de Spinoza.” In: Revue philosophique de Louvain 76 (1978), 427-446 [cf. Spinoza-Bibliografie dat aantekent: “Über einen Brief an L. Meyer vom 26. Juli 1663 (incl. Abdr.).”
Ik neem hier de recensie over die Adrien Klajman in het Bulletin de Bibliograpie Spinoziste gaf van Spinoza et Leibniz: l'idée d'animisme universel
Ce livre répond à trois exigences:
a) La première constitue la trame philosophique de l'ouvrage: l'auteur
présente, autant sous forme de réfutation historique (notes sur l'Éthique prises par Leibniz en 1678)
que de circulation et d'échange thématiques, les développements spinozistes et
leibniziens sur le mécanisme cartésien et ses effets théoriques dans l'étude du
vivant (Introduction en Première Partie). A propos de questions de biologie, R.
Bouveresse dégage le contenu rationaliste qui préside à l'épistémè post-cartésienne: celle-ci n'a pas le sens d'une
reformulation d'un univers péripatéticien en mal de défenseurs ni d'une audace
de cartésiens, mais prend acte des réquisits d'universalité de la physique
cartésienne pour produire de nouveaux concepts en rupture à la fois avec
l'ancienne métaphysique et la science cartésienne (Première Partie). Le conflit
autour des principes métaphysiques (Dieu ou substance unique de Spinoza, entre
expression monadique ou pluralisme substantiel de Leibniz) s'ordonne à un
complexe physico-biologique doublement renouvelé: or l'auteur nous éclaire sur
la radicalité des deux démarches dont l'unité se lit dans cette articulation
rigoureuse entre le dispositif métaphysique et la conceptualisation
scientifique.
b) La seconde exigence est d'ordre épistémologique et sémantique: elle double en effet le système des réfutations et échos thématiques par l'élucidation interrompue et reprise du vocabulaire de « l'animisme universel » (Introduction, Conclusion, en Première Partie). Nourrie par la terminologie des biologistes contemporains (Canguilhem, Jacob, Monod), la sémantique de l'animisme permet, depuis l'horizon de notre modernité scientifique, une lecture qui accorde les interprétations classiques (Zac, Matheron, et J. Mo-reau, Serres) aux enjeux de la rationalité épistémologique (chapitres V et VI). « L'alliance animiste » ne traduit plus la lutte simpliste entre savants et philosophes, objectivation du vivant et idéologie philosophique de la vie, mécanisme et finalité anthropomorphique (âme du monde inspirant un vitalisme non scientifique): c'est toujours déjà dans un cadre rationaliste, posé par l'auteur, qu'elle se soucie d'adapter des instruments scientifiques à la spécificité de la vie telle qu'elle apparaît au xvile, et se thématise depuis Stahl (chapitre VII).
c) A partir de là, l'exigence historique trouve sa méthodologie rigoureuse: le jeu des influences et des critiques leibniziennes, relayé par Foucher de Careil, qui visent Spinoza, est réglé par les deux axes précédents. Il met au jour une même cohérence philosophique sous laquelle la sémantique animiste inscrit diversement Spinoza et Leibniz sur l'axe épistémologique. Le premier permet de déduire d'une nouvelle métaphysique de la Vie une méthodologie épistémologique, le second retravaille l'ancienne métaphysique animiste à partir d'une réévaluation de l'approche expérimentale et mathématique de la nature.
Les deux moteurs d'explication, historico-philosophique et épistémologique, qui gouvernent le jeu des influences, justifient la logique des trois Appendices de l'ouvrage: R. Bouveresse fonde la publication de textes de Leibniz et Meyer ainsi que l'accent épistémologique de l'Appendice III: « Popper et Leibniz: Critique du panpsychisme et panpsychisme embryonnaire ».
Adrien KLAJNMAN
In: BULLETIN DE BIBLIOGRAPHIE SPINOZISTE XV In: Archives de Philosophie, Vol. 56 [1993], No. 4, PHILOSOPHES EN ITALIE (I) (OCTOBRE-DÉCEMBRE 1993), pp. 1-50